Partager la page
L’Amérique latine face à la question migratoire : entre crise, défis et opportunités pour promouvoir le développement durable
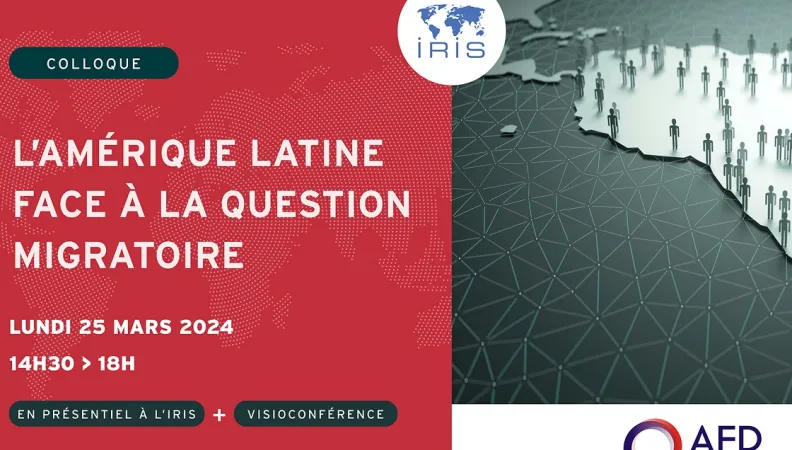
-
Quand
-
-
Horaires
-
14h30 - 18H
-
Où
-
En présentiel à l'IRIS ou en visioconférence
Les phénomènes migratoires accompagnent l’histoire de l’Amérique latine dans la longue durée et cette région a, en particulier, toujours constitué une terre de migrations internationales. L’AFD et l'Institut des Relations Internationales Stratégiques (IRIS) co-organisent une conférence afin de mieux comprendre les enjeux des migrations sur l’élaboration de politiques publiques favorables à un modèle de développement durable pour la région.
Les phénomènes migratoires accompagnent l’histoire de l’Amérique latine dans la longue durée et cette région a, en particulier, toujours constitué une terre de migrations internationales. L’AFD et l'Institut des Relations Internationales Stratégiques (IRIS) co-organisent une conférence afin de mieux comprendre les enjeux des migrations sur l’élaboration de politiques publiques favorables à un modèle de développement durable pour la région.
Dans la période contemporaine, la question migratoire régionale est souvent associée, parfois réduite, à celle des flux mexicains, centre-américains et caribéens croissants (et désormais sud-américains devenus les plus importants) vers les Etats-Unis. Si ces derniers constituent bien un aspect central de la question migratoire latino-américaine, elle ne s’y réduit pas. En effet, ces dernières années, le thème migratoire s’est partout imposé dans le débat public latino-américain à mesure que tous les pays de la région sont devenus concernés par le phénomène, soit en tant que pays de départ, de transit, d’arrivée ou de retour - ou en cumulant plusieurs de ces statuts simultanément.
En effet, si l’Amérique latine n’est pas la région du monde vers laquelle s’oriente la part la plus importante des migrations internationales, elle est en revanche l’une de celle où les problématiques de mobilités humaines (volontaires ou contraintes) se sont le plus développées ces dernières années. Ainsi, selon les Nations unies, 43 millions de latino-américains vivaient en dehors de leur pays d’origine en 2020, ce chiffre représentant 15 % de la population migrante mondiale. En 2000, ils étaient 25 millions. Et entre 2000 et 2020, les migrants intra-régionaux (c’est-à-dire au sein des pays latino-américains) sont passés de 6,5 millions à 15 millions. Dans ce contexte, en Amérique du Sud, près de 80 % des migrants vivent dans un autre pays sud-américain[1].
Cette situation de généralisation de la question migratoire à toute l’Amérique latine trouve ses causes dans de multiples dynamiques qui s’entremêlent depuis le début du 21e siècle : crises économiques à répétition dans tous les pays, crise sanitaire (Covid-19) et ses conséquences socio-économiques, intensification et diversification des désastres environnementaux liés aux dérèglements climatiques, crises institutionnelles et politiques qui favorisent les départs, généralisation des violences liées en particulier au développement du crime organisé et du narcotrafic, ainsi qu’à la militarisation croissante des sociétés latino-américaines. Ces phénomènes et leur imbrication aggravent les problèmes sociaux structurels existants au sein de chaque société latino-américaine parmi lesquels la pauvreté, les inégalités sociales, l’accroissement du secteur informel, l’insécurité alimentaire, le chômage, le manque d’opportunités, etc. figurent en tête. Et constituent autant de motifs pour migrer.
À mesure que les impacts du changement climatique s’intensifient, il est essentiel de comprendre si l’humanité est sur la bonne voie pour s’adapter ou sur la voie d’une augmentation des niveaux de risque. Cela soulève de nombreux défis, notamment méthodologiques. Dans le sillage de la COP28, cette conférence vise à explorer les outils qualitatifs innovants pour mesurer les progrès d’adaptation, offrant des perspectives complémentaires aux méthodes quantitatives traditionnelles.
Programme
- 14H – Accueil du public
- 14H30 – Allocution d’ouverture
- 14H45 / 16H – Mouvements migratoires en Amérique Latine : état des lieux et enjeux
- 16H00 / 16H20 – Présentation du projet AFD/Expertise France : « Mujeres echando raices »»
- Pause – 16h20/16h35
- 16H35 / 17H50 – Pour une gouvernance migratoire humaine : les défis du développement durable
- 17H50 – Cocktail
