Partager la page
L’aide au développement à l’épreuve des contextes de conflit
Publié le
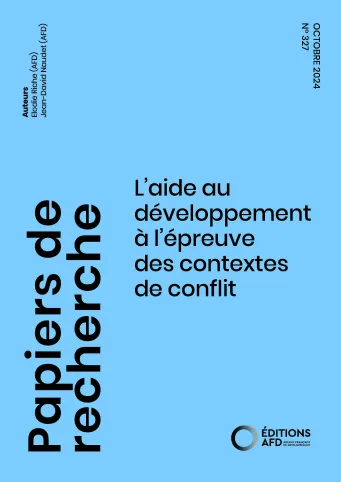
L’aide au développement entretient avec l’intervention dans les conflits armés des relations anciennes et controversées. Cependant, les interventions internationales visant à stabiliser des États fragiles telles qu’elles ont été menées depuis les années 1990 semblent parvenir à la fin d’un cycle, marqué par des engagements massifs en Afghanistan et en Irak. Ces opérations ont été marqué par les doctrines de contre-insurrection et de stabilisation, associant interventions militaires et développement pour pacifier les régions en proie à des conflits.
Cette association a été conceptualisée par les milieux de l’intervention internationale sous le terme de « nexus sécurité-développement », très fortement liée à la notion d’État fragile. Le nexus sécurité-développement, qui postule que développement et sécurité sont interdépendants, a fini par s’imposer comme un paradigme dominant dans les relations internationales post-Guerre froide. La communauté internationale a ainsi mis en place des opérations dites "multidimensionnelles" qui tentent de prendre en compte à la fois les aspects sécuritaires, humanitaires et de développement dans les zones de crise. Les Nations Unies et d’autres acteurs, comme la Banque mondiale et l’OCDE, ont adopté cette approche, cherchant à articuler les interventions militaires et l’aide au développement pour instaurer la paix et renforcer les institutions locales. Les premières difficultés ont plus tard poussé les bailleurs à améliorer leurs pratiques en développant une approche dite « sensible au conflits », visant notamment à mieux comprendre les contextes et à « ne pas nuire ».
Pourtant, malgré ces efforts, l’impact des projets de développement sur la réduction de la violence et la stabilisation des zones de conflit reste limité. Bien que de nombreux projets aient atteint leurs objectifs de développement immédiats (création d’infrastructures, accès à des services de base), leur effet sur la diminution des conflits et sur la transformation durable des sociétés est incertain. Ainsi se manifeste ce que certains appellent "la revanche des contextes" : les particularités locales des zones en conflit ainsi que les effets inattendus des projets finissent souvent par réduire à néant les effets escomptés des interventions extérieures. Or, la volonté de cohérence des bailleurs les a souvent menés à privilégier un alignement envers les visions internationales voire nationales, au détriment de la cohérence avec « le terrain » et les priorités locales. Par ailleurs, les efforts réels de connaissance des contextes n’ont pas suffi lorsque les enjeux stratégiques étaient trop importants, faisant remonter les décisions dans des sphères hiérarchiques ne pouvant les exploiter.
Ces échecs soulignent la nécessité d’un réexamen des pratiques de développement dans les contextes de conflit. D’un côté, ils appellent à une réduction des ambitions, en particulier celles qui visent à transformer profondément les sociétés touchées par des conflits. Les attentes doivent être réalistes, et les projets de développement ne peuvent plus prétendre avoir un impact transformationnel dans ces contextes. D’un autre côté, ils appellent à une meilleure coordination entre les différents acteurs de l’aide au développement, en particulier au niveau local. Les initiatives les plus réussies semblent être celles qui sont ancrées dans une compréhension fine et contextuelle des réalités locales, comme en témoigne le succès relatif de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix au Niger.
Un objectif pourrait être d’aller vers une aide plus "sensible au terrain". Cela impliquerait de renverser les chaînes de décision, en accordant plus de poids aux acteurs locaux qui détiennent une connaissance approfondie des contextes de crise, même si cette approche présente des défis majeurs en termes de redevabilité et de gestion des risques. Cette aide "sensible au terrain" pourrait ainsi augmenter les chances de succès des interventions, en permettant une adaptation plus flexible aux réalités locales et en maximisant les opportunités de réduction de la conflictualité.
Infos pratiques
-
Auteurs
-
Jean-David Naudet, Elodie RICHE
-
Numéro
-
327
-
Nombre de pages
-
33
-
ISSN
-
2492 - 2846
