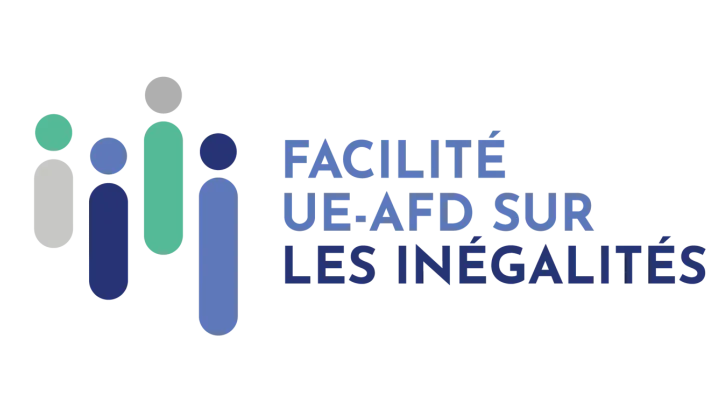Partager la page
Polynésie : « faire l’école autrement » grâce aux Aires marines éducatives
Publié le

Comment sensibiliser les élèves aux ressources naturelles et culturelles de leur environnement proche ? Grâce aux Aires marines éducatives (AME), ils sont formés à la gestion du milieu maritime qui les entoure et prennent conscience de leur territoire, de leur culture et de l'importance du développement durable.
« Connaître, vivre et transmettre la mer » : ce sont les trois piliers pédagogiques des Aires marines éducatives (AME), zones gérées de manière participative par un établissement scolaire. Elles permettent en effet aux élèves d’acquérir des connaissances, de mettre en œuvre des actions et de sensibiliser leur entourage… Les élèves deviennent alors ambassadeurs des Aires marines éducatives.
Le concept d’Aire marine éducative est né aux îles Marquises en 2012, à l’école primaire de Vaitahu, sur l’île de Tahuata. Dans le cadre de la campagne océanographique Pakaihi i te moana, le récit des scientifiques a donné envie aux élèves de prendre soin de leur propre aire marine, en face de leur école. Le projet est aujourd’hui porté par les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de l’Éducation nationale, des Outre-mer et par l’Office français de la biodiversité (OFB).
Les établissements scolaires ne sont pas soumis à des obligations réglementaires, mais ils sont récompensés par un label dont l’obtention est conditionnée par leurs réalisations : mise en place d’un « Conseil pour la mer » qui définit actions à mener, charte AME, diagnostic écologique… Différentes activités sont proposées aux élèves, comme des randonnées aquatiques, des animations en classe et en bord de mer, la restauration de coraux…
L’AME est également un support pédagogique qui peut être utilisé dans toutes les disciplines : « Le projet AME permet de faire travailler quasiment toutes les compétences demandées à des élèves de cycle 3 en donnant du sens à ces apprentissages, grâce à une approche concrète des points étudiés : la classification des êtres vivants prend tout son sens quand il s'agit de déterminer la nature des animaux collectés, par exemple, explique Guillaume, enseignant à l’OFB. En géographie, cela a été l'occasion de travailler sur l'aménagement du littoral par l'Homme, sur l'influence du tourisme sur la zone. »
Lire aussi : 5 bonnes raisons de s'intéresser (enfin) aux océans
L’action de l’AFD en Polynésie française
Les AME, gérées en Polynésie française par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), ont fait l’objet d’une convention de financement en 2020 entre l’AFD et le ministère de l’Éducation et de la Modernisation de l’administration de la Polynésie française (MEA).
L’AFD a ainsi alloué 43 000 euros (5 millions F CFP) à la DGEE afin d’apporter une assistance juridique en matière de labélisation, de dépôt de marque « AME » et de promotion numérique à travers le financement de clips vidéo et d’affiches.
En soutenant cette initiative, l’AFD souhaite participer à la sensibilisation des générations futures aux enjeux durables de demain et à la préservation de la biodiversité polynésienne, en lien avec les objectifs de l’AFD de promotion du lien social et de soutien à la transition écologique.
Lire aussi : « Il n’y aura pas de transition écologique juste sans investissements dans l’éducation »
Dialoguer avec les acteurs de la mer
Depuis leur création, les AME sont en constante augmentation. En Polynésie française, on recense aujourd’hui une trentaine d’écoles labellisées et le programme compte plus de 5 000 élèves gestionnaires depuis 2013. Le concept rayonne jusque dans l’Hexagone et dans d’autres territoires d’Outre-mer. Au total, ce sont 261 projets AME qui ont émergé en France métropolitaine et dans les Outre-mer.
Les AME font appel à des scientifiques qui accompagnent, forment et assistent professeurs et élèves, du primaire à la troisième, à la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. Les élèves se réunissent lors du « Conseil pour la mer », puis rencontrent les tavana (maires) des communes qui délimitent les aires marines sur lesquelles les actions doivent être menées.
La collaboration étroite entre la DGEE et l’OFB a permis de consolider, dans chaque île, des partenariats avec les parents d’élèves, les associations, les conseils municipaux et les scientifiques. La démarche éducative a également contribué à l’essor d’un dialogue entre les élèves et les acteurs de la mer comme les usagers, les professionnels (pêcheurs et autres métiers de la mer), les collectivités locales ou les gestionnaires d’espaces naturels. Les métiers de la mer, fondamentaux en Polynésie française, sont ainsi valorisés.