Partager la page
Comment le manque de données freine la lutte contre les inégalités
Publié le
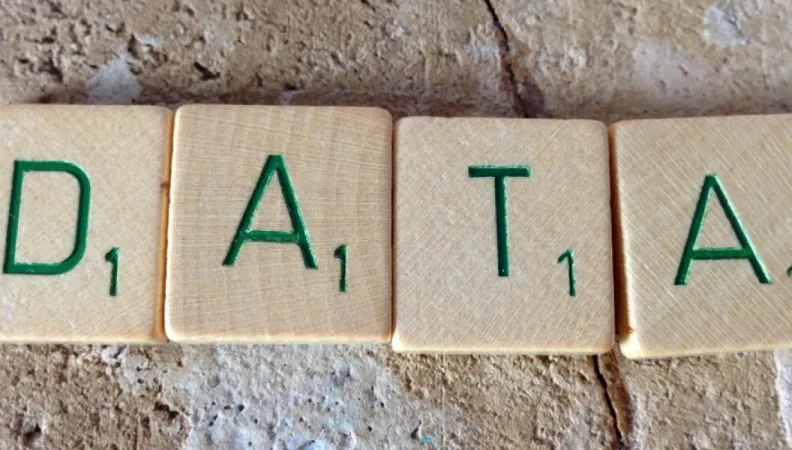
La lutte contre les inégalités se heurte encore à un obstacle de taille : le manque de données permettant de les mesurer avec précision.
C’est une question qui revient sans cesse au sein des agences et banques de développement du monde entier, Agence française de développement (AFD) comprise : les projets financés sont-ils efficaces ? Ou, pour le dire autrement : dans quelle mesure profitent-ils aux personnes dont ils sont censés améliorer les conditions de vie ?
C’est vrai pour les projets en lien avec l’accès aux soins, à l’eau, à l’éducation, à l’énergie, au logement ou à l’emploi. Ça l’est encore plus pour ceux visant à lutter contre les inégalités. Car l’Objectif de développement durable n° 10 des Nations unies – « Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre » – se heurte aujourd’hui à un obstacle de taille : le manque de données permettant de les mesurer avec précision.
« La question de la collecte des données fiables et de sources diverses est centrale, car elles seules permettent de tenir un discours cohérent sur l’évolution des inégalités », soulignait Gaël Giraud, chef économiste de l’AFD, à la conférence sur les inégalités organisée par l’AFD début décembre à Paris.
Le handicap, grand oublié
Or, dans de nombreux pays, les instituts nationaux de statistiques ne produisent pas de données assez fines pour permettre de mesurer les différentes inégalités. « Ceux-ci fonctionnent de façon autonome, sans penser aux chercheurs et analystes qui ont besoin de données précises sur les revenus, l’accès à l’éducation, aux soins », confie Mathias Kuepie, chercheur à l’AFD.
Les données sont, pour ainsi dire, le nerf de la guerre. Qu’elles viennent à manquer, et on ne saura plus si les inégalités s’aggravent ou, au contraire, se résorbent. À condition, toutefois, que les données collectées soient pertinentes et exhaustives. C'est là un autre défi auquel sont confrontés les spécialistes : quelles inégalités faut-il mesurer exactement, et à quel niveau doit-on les observer ?
« Il existe plein de formes de discriminations, d’inégalités. Certaines sont sur le devant de la scène pendant que d’autres sont oubliées. Le handicap, par exemple, n’est pas pris en compte dans les systèmes éducatifs de nombreux pays. Il faudrait traiter les inégalités comme un ensemble, afin qu’aucune n’apparaisse plus importante qu’une autre », pointe Rohen d’Aiglepierre, économiste spécialisé dans l’éducation et l’emploi à l’AFD.
Les inégalités de revenus comptent parmi les plus étudiées. Pourtant, la question n’est pas tranchée de savoir si elles doivent être analysées à partir des revenus individuels ou de ceux du foyer. Plus parlante pour évaluer le niveau de vie d’une famille, la deuxième option peut, dans le même temps, masquer de fortes disparités entre ses membres. La plupart des travaux s’intéressent par ailleurs aux inégalités de revenus sans tenir compte des processus qui les ont amenées, comme la croissance économique du pays.
Améliorer l’accès des femmes à l’emploi
« Dans nos pays d’intervention, on regarde depuis longtemps le nombre d’années d’éducation des élèves. Mais sans savoir s’ils ont passé leur scolarité actifs au premier rang ou passifs au fond de la classe. Ces données ne sont pas collectées. On peut donc difficilement se prononcer sur la qualité de leur éducation », déplore Rohen d’Aiglepierre.
« De même, si on veut réduire les inégalités entre hommes et femmes en favorisant l’accès de ces dernières au marché de l’emploi, encore faut-il s’assurer qu’il s’agit d’emploi de qualité, et donc être en capacité de le mesurer, en sachant estimer ce qu’est un emploi de qualité, ainsi que les externalités positives et négatives de cet emploi », poursuit-il.
Le défi de l’évaluation
Les défis des chercheurs ne s’arrêtent pas là. Car avant de préconiser telle ou telle politique de lutte contre les inégalités, encore faut-il être en mesure d’estimer celle qui peut fonctionner dans un contexte local. Or, évaluer les résultats d’un programme de lutte contre les inégalités est loin d’être une mince affaire.
Des programmes très coûteux
Si les inégalités restent aujourd’hui complexes à évaluer, c’est en premier lieu parce qu’« il est difficile pour les pays les plus pauvres de financer les études nécessaires », constate Mathias Kuepie. Celles-ci demandent en effet des moyens financiers importants et réguliers.
L’Agence française de développement a donc fait le choix de soutenir de façon plus intense la recherche sur les inégalités dans plusieurs régions du monde, grâce à une facilité financière de 4 millions d’euros issue de la Commission européenne pour la période 2017-2020.
« Nous finançons par exemple un programme sur la réussite socio-économique des femmes au Burkina Faso. L’idée est de décrypter les mécanismes conduisant à la construction des inégalités femmes-hommes sur le marché du travail, en s’intéressant à différents aspects de la vie des personnes interrogées : éducation, famille, migration, vie professionnelle », décrit le chercheur. De quoi espérer, dans quelques années, disposer de données suffisamment fiables pour enrayer l’accroissement des inégalités dans le monde. Avec un maximum d'efficacité.
EN SAVOIR PLUS SUR...
