Partager la page
Revue « Global Africa » : penser les futurs africains en réponse aux défis planétaires
Publié le
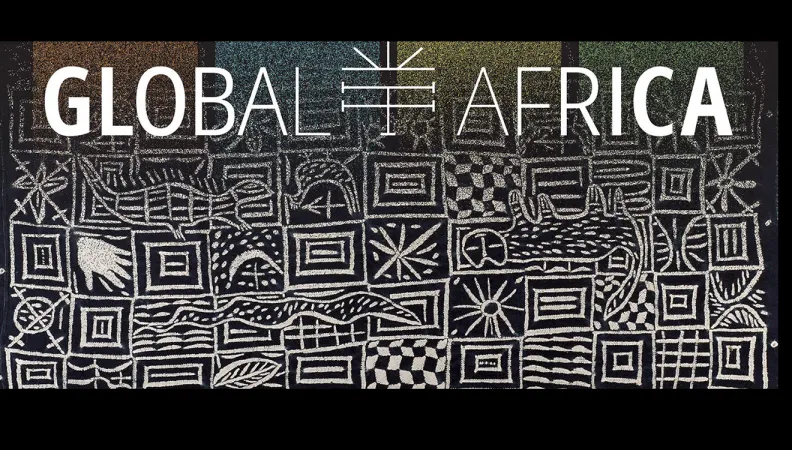
La nouvelle revue scientifique « Global Africa » vient de voir le jour - un lancement célébré par le colloque « African Research Matters », organisé du 15 au 18 mars à Saint-Louis du Sénégal. Fondée par l'Université Gaston Berger (UGB), en association avec l’Institut de recherche pour le développement et l’appui financier de l’AFD, cette revue pluridisciplinaire vise à valoriser la recherche africaine et à accompagner les jeunes chercheurs et chercheuses. Entretien avec la rédactrice en chef Mame-Penda Ba, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l’UGB et directrice du Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs d’Afrique et diasporas (Laspad).
Revue Global Africa
Comment est née la revue Global Africa et quels sont ses principaux objectifs ?
Mame-Penda Ba : Depuis quatre ou cinq ans, avec des collègues de l'Université Gaston Berger (UGB) et de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), nous étions frustrés de l’absence, dans le paysage académique sénégalais, d’une revue de standard international qui porte les résultats de la recherche africaine et les diffuse dans plusieurs langues. Des travaux très intéressants existent mais ne sont publiés par aucun dispositif éditorial de qualité, ils restent souvent limités à une lecture entre pairs d’une même université. L'idée était donc là, presque déjà mure, et lorsque l’AFD a lancé son appel à initiatives, nous avons approché le Codesria, le LASDEL, l’UIR et d’autres institutions de recherche pour aller vers une revue commune. C'est là qu’est née Global Africa.
Vous écrivez dans l’article qui fait l’ouverture du premier numéro, en écho à Achille Mbembe, que « le défi africain du XXIe siècle est le devenir savant de l’Afrique ». Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
M.-P. B. : Par ce concept, nous voulons dire qu’il n'y aura pas de transformation durable sur le continent africain si l'écosystème global de la production de connaissances, d'innovations, d'idées, n'est pas littéralement révolutionné. C’est cette recherche qui fournira les réponses dont l’Afrique et le monde ont besoin, et c’est par là que le continent prendra la part qui est la sienne dans la production mondiale de connaissances. Cette recherche aura de plus un impact non seulement sur les enseignements que nous fournissons – pour être pertinents, les enseignements doivent être nourris par une recherche permanente – mais aussi sur les politiques publiques, qui doivent s'appuyer sur des données probantes, sur des prédictions robustes et sur les apports de la science de la durabilité. Il faut donc soutenir la recherche publique africaine, afin qu’elle puisse produire des résultats qui serviront aux organisations de la société civile, au secteur privé et aux politiques publiques de l'État.
Lire aussi : Global Africa, une revue pour dynamiser la recherche en Afrique
Quels sont les principaux sujets des deux premiers numéros ?
M.-P. B. : Nous avons navigué entre un premier numéro qui porte sur une thématiques très large intitulé « Afriques, mondes et savoirs de demain » et un second plus spécialisé, prévu en fin d’année, qui s'intéressera à la question de la viralité. Les questions abordées dans le numéro inaugural couvrent la reconstruction des savoirs en Afrique, le changement climatique, l’humanitaire... Nous espérons que ces thématiques très ouvertes susciteront de nombreux débats. Quand Cecelia Lynch écrit par exemple, dans ce premier numéro, qu’il faut recentrer l'humanitarisme global en Afrique et intégrer dans l'humanitaire toutes les problématiques liées aux croyances, aux valeurs et aux normes, elle ouvre un vrai chantier de recherche.
La revue sera en accès libre en ligne et multilingue (français, anglais, arabe et swahili). C’est important qu’elle soit diffusée et lue le plus largement possible ?
M.-P. B. : Oui, dès le départ, le parti pris a été de créer une revue accessible à un maximum de chercheurs du continent, de la diaspora, et à tous ceux qui s'intéressent aux défis globaux en Afrique. C’est pour cette raison que l’option « open access diamant » a été privilégiée. Quant au multilinguisme, il est au cœur de notre projet car nous voulons à travers la revue démontrer que les langues africaines sont des langues de recherche à part entière : au-delà du français, de l'anglais, de l'arabe et du swahili, nous espérons intégrer à moyen terme d’autres langues africaines, ainsi que le portugais et l’espagnol pour engager le dialogue avec les diasporas des Caraïbes et de l’Amérique latine.
Dans le cadre du colloque organisé du 15 au 18 mars à Saint-Louis pour le lancement de la revue, plusieurs conférences sont prévues sur le développement durable, la protection de l’environnement. Il s’agit de thèmes essentiels des « futurs africains en réponse aux défis planétaires » ?
M.-P. B. : Tout à fait. Avoir une attention soutenue à la protection de la nature est primordial. Pour sortir du mimétisme des trajectoires de développement occidentales, qui ont clairement montré leurs limites du fait de l'extractivisme, nous devons penser simultanément le devenir savant de l'Afrique avec une forme de révolution écologique au niveau planétaire. Les deux efforts sont tellement importants que nous devons les articuler ensemble.
C’est par là que nous rencontrons la question de la durabilité. Nous ne souhaitons pas une recherche désincarnée, mais une recherche qui contribue à améliorer le bien-être durable des populations, sur tous les plans : environnement, santé, éducation, sécurité... Pour cela, il faut d’une part faire de la recherche différemment, de manière inclusive – associer les citoyens, le secteur privé, les décideurs publics aux côtés des chercheurs pour trouver des solutions. Et d’autre part, porter la voix des chercheurs dans les espaces de gouvernance internationaux. Nous travaillons beaucoup sur les agendas internationaux, en particulier les ODD et l'Agenda 2063 de l'Union africaine, et nous pensons que sur ces problématiques, les chercheurs africains ont des options à mettre sur la table.
Découvrir : Conversations de recherche, un nouveau rendez-vous en ligne
Dans le premier numéro, vous donnez la parole à autant de femmes que d’hommes…
M.-P. B. : Tout à fait : Fatima Sadiki, Cecelia Lynch, Giulia Bonacci, moi-même… Quatre femmes sur huit scientifiques en tout. C'était très important pour nous de respecter un équilibre, dans le comité de rédaction également.
Si la scolarisation des filles en primaire, au collège et au lycée tend vers l’équilibre dans de nombreux pays africains, à l’université, l’écart hommes-femmes se maintient clairement. Dans ma faculté, par exemple, nous sommes cinq femmes sur près de soixante enseignants-chercheurs. Le rôle social attendu de la part des femmes fait qu’elles ont tendance à quitter le milieu académique du fait de ses contraintes et exigences. Il faut donc des politiques sexo-spécifiques bien définies pour encourager les jeunes femmes à aller le plus loin possible dans leurs études universitaires, y compris dans les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et à faire partie de l’académie. Il faut soutenir la voix des femmes – c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur les jeunes femmes chercheuses, qui ont des choses fascinantes à dire.
Autour de la revue se grefferont justement des actions d’accompagnement des jeunes chercheurs et chercheuses : écoles de jeunes chercheurs, mentorats, formations dans les domaines de l’écriture et de l’édition scientifique… Il s’agit de renforcer leurs capacités de production et de valoriser leurs travaux ?
M.-P. B. : Le défi de Global Africa, c’est de mettre en valeur l'une des ressources les plus remarquables du continent africain : sa jeunesse, avec toute son énergie, ses idées, son désir d’être partie prenante de la marche du monde… C’est pourquoi nous devons les accompagner, les écouter, les préparer à un leadership éclairé et démocratique. Dès l’année prochaine, nous publierons un ou deux numéros par an consacrés entièrement aux jeunes chercheurs et chercheuses. Et en parallèle, nous souhaitons leur offrir une formation de qualité et un espace dans lequel ils peuvent dessiner leurs propres trajectoires. Notre objectif n’était pas de porter une nouvelle fois la voix des élites africaines, qui sont déjà représentées dans les universités à travers le monde, mais de montrer que sur ce continent et dans la diaspora africaine, il y a des jeunes qui ont un potentiel fabuleux.
Nous souhaitons que Global Africa soit un espace privilégié dans lequel des grands noms pourront tenir la main à cette jeune génération, en leur laissant bien sûr toute leur marge de liberté, pour les aider à éclore et à gagner en robustesse sur le plan scientifique. Ils seront aussi formés à rendre les contenus scientifiques plus accessibles au grand public, à promouvoir leurs travaux en ligne… Le suivi sera très complet.
Le premier numéro de Global Africa est disponible ici
Pour assister au colloque en ligne, cliquez ici
