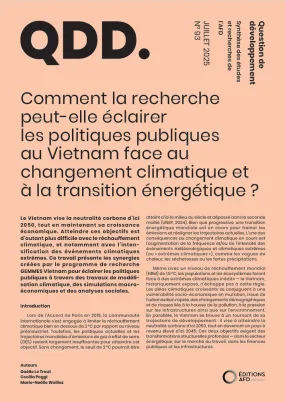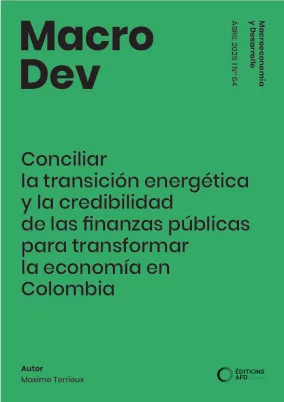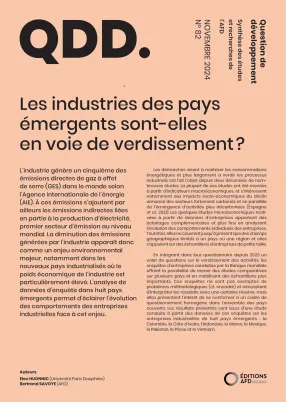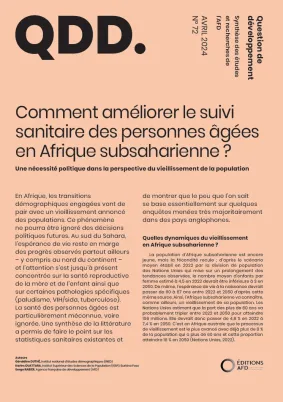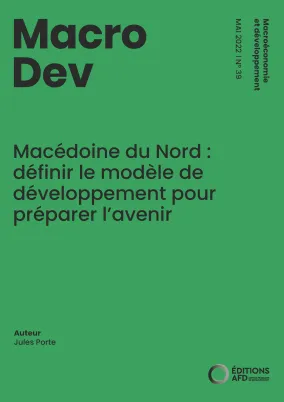ESTEEM Cambodge est bien plus qu'un simple exercice de modélisation : il s'agit d'un outil macroéconomique dynamique conçu pour permettre aux décideurs publics cambodgiens de prendre, en temps réel, des décisions pour planifier une transition verte juste et durable. En reliant les dimensions énergétique, fiscale et sociale, le projet renforcera la capacité du gouvernement cambodgien à identifier et à gérer les risques économiques et structurels liés à la transition vers une économie bas carbone.
ESTEEM Cambodge est bien plus qu'un simple exercice de modélisation : il s'agit d'un outil macroéconomique dynamique conçu pour permettre aux décideurs publics cambodgiens de prendre, en temps réel, des décisions pour planifier une transition verte juste et durable. En reliant les dimensions énergétique, fiscale et sociale, le projet renforcera la capacité du gouvernement cambodgien à identifier et à gérer les risques économiques et structurels liés à la transition vers une économie bas carbone.
Contexte
Depuis le rétablissement de la paix au début des années 1990, le Cambodge a connu une croissance économique rapide, portée par les secteurs du textile, du tourisme et de la construction. Le pays devrait sortir de la catégorie des pays les moins avancés d'ici 2030. Ce passage de l'agriculture à l'industrie manufacturière n'a pas entraîné une augmentation du nombre d'emplois, mais plutôt une diversification des emplois, qui sont de plus en plus formels et urbains, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, tout en renforçant la dépendance du Cambodge à l'égard des combustibles fossiles et de l'électricité importée.
Afin de soutenir la croissance tout en poursuivant ses ambitions climatiques, le gouvernement royal du Cambodge a défini des stratégies claires pour une transition vers une économie à faible intensité de carbone. Cette transformation s'accompagne toutefois de nouveaux défis macroéconomiques et budgétaires, dans un contexte de demande énergétique croissante, de vulnérabilité du commerce extérieur et de pressions sur les finances publiques. Comprendre ces défis et leurs interactions est essentiel pour concevoir une stratégie de transition énergétique à la fois réaliste et financièrement viable.
Objectifs
Le projet ESTEEM Cambodge appuie le gouvernement cambodgien dans l'élaboration d'une stratégie réaliste et financièrement viable pour la transition énergétique du pays. Grâce à des activités de modélisation macroéconomique, il vise à :
- Identifier les risques macroéconomiques qui pourraient survenir lors de la transition vers une énergie plus propre, notamment en matière de dette publique, d'emploi, d'inégalités de revenus et de stabilité monétaire
- Explorer comment différents scénarios énergétiques interagissent avec l'économie dans son ensemble.
Pour y parvenir, des équipes de recherche basées à Paris et à Phnom Penh conçoivent un modèle macroéconomique adapté à l'économie cambodgienne. Elles travaillent en étroite collaboration avec les principaux ministères afin de s'assurer que ce modèle devienne un outil efficace pour la planification stratégique. Cela permettra aux décideurs publics, en particulier le ministère de l'Économie et des Finances, de prendre des décisions étayées par des données et d'élaborer une stratégie à long terme en faveur de la neutralité carbone.
QU’EST-CE QU'ESTEEM ?
Le modèle ESTEEM Cambodge est une adaptation du modèle ESTEEM développé par l'AFD. Ce modèle permet d'identifier les risques de transition auxquels sont confrontées les économies en développement, permettant ainsi aux décideurs politiques d'anticiper ces risques et de concevoir une trajectoire de transition adaptée au contexte spécifique de chaque pays.
Méthode
Le projet ESTEEM Cambodge est la deuxième phase d'une collaboration entre le gouvernement royal du Cambodge et l'AFD. Il s'appuie sur les résultats d'une première phase, qui a permis de créer un modèle facile d'utilisation appelé CEPIA, conçu pour le secteur de l'énergie cambodgien. Développé avec iED Consult pour le ministère des Mines et de l'Énergie, CEPIA a produit quatre scénarios énergétiques basés sur les plans de développement et d'action climatique du gouvernement.
Dans la phase 2, CEPIA sera connecté au modèle ESTEEM afin d'étudier les impacts macroéconomiques des quatre scénarios énergétiques, tout en les reliant à des objectifs socio-économiques plus larges (croissance du PIB, investissements, création d'emplois, etc.).
Le projet est mené conjointement par des chercheurs de l'AFD, l'université Grenoble Alpes et iED Consult, en étroite collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances. Des membres de plusieurs ministères cambodgiens participent activement au développement du modèle, ainsi qu'à des ateliers et des activités de formation, contribuant ainsi à renforcer l'expertise locale en matière de modélisation macroéconomique.
Résultats attendus
Le projet aboutira à :
- Un modèle macroéconomique ESTEEM adapté au contexte cambodgien, intégrant les scénarios énergétiques du modèle CEPIA développés lors de la phase I ;
- Un ensemble de simulations analysant les implications macroéconomiques des quatre scénarios de transition énergétique du Cambodge ;
- Un outil interactif pouvant être utilisé par les responsables gouvernementaux pour simuler différents scénarios et politiques, notamment en matière de transition énergétique.
Contact
- Guilherme MAGACHO, AFD
- Isabelle FERAUDO, Université Grenoble Alpes
- Gaëlle LE TREUT, AFD
- Seav Er HUY, AFD Phnom Penh
- Somalyneth SARBOEUN, AFD Phnom Penh
Vous souhaitez suivre l'actualité de la recherche à l'AFD ?
A lire aussi
Découvrir d'autres projets de recherche
 © Domaine public Centré sur trois pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord), ce projet de recherche multidisciplinaire explorera les enjeux du vieillissement démographique et la manière dont ils impactent les contextes socio-économiques et climatiques, ainsi que les politiques publiques actuelles et à venir dans chaque pays étudié.
© Domaine public Centré sur trois pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord), ce projet de recherche multidisciplinaire explorera les enjeux du vieillissement démographique et la manière dont ils impactent les contextes socio-économiques et climatiques, ainsi que les politiques publiques actuelles et à venir dans chaque pays étudié.
Contexte
Selon les Nations unies, le vieillissement est un « évènement sans précédent dans l’histoire de l’humanité ». L’année 2020 marque un moment historique de bascule : les courbes d’évolution de la proportion des personnes de 65 ans et plus d’une part, et les personnes de moins de cinq ans d’autre part, se croisent et s’engagent dans des directions fortement divergentes.
Ces changements, déjà à l’œuvre en Europe et dans les Balkans, annoncent de grands défis sanitaires, sociaux et économiques dans les décennies à venir, ainsi qu’un déclin démographique déjà engagé. Pour y faire face, il faudra se confronter aux transformations inévitables des modes de vie, augmenter les investissements dans les politiques de protection sociale, réformer les institutions et encourager l’innovation technologique. Sans actions spécifiques en matière de politiques publiques, la baisse de la population active compliquera le soutien aux retraités, les problèmes de santé liés à l’âge s’aggraveront, et la la qualité de vie des personnes âgées se trouvera réduite.
Objectif
Ce projet de recherche vise à identifier, décrire et analyser clairement les liens entre les dynamiques démographiques et les enjeux socio-économiques dans trois pays des Balkans occidentaux.
Pour cela, il s’intéressera aux dynamiques de population (mortalité/morbidité, vieillissement, migrations) et aux modes de (dé)peuplement et d’aménagement des territoires (identités territoriales, urbanisation/ espaces ruraux, en particulier en lien avec les milieux naturels). Il analysera aussi leurs impacts et leurs interactions avec les enjeux socioéconomiques présents et à venir dans chacun des trois pays concernés (accès des femmes au marché du travail, remises des migrants, évolution des systèmes de protection sociale…).
Il s’agit d’identifier, de décrire et d’analyser clairement ces liens, à la fois pour alimenter la recherche académique et pour éclairer les choix de politiques publiques dans les trois pays concernés. L’AFD pourra également utiliser ces résultats dans ses échanges avec les autorités publiques en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord.
Méthode
La conduite du projet a été confiée à un partenaire scientifique, le Center for Research and Policy Making (Macédoine du Nord). Ce dernier a réuni une équipe multidisciplinaire composée d'experts en démographie, en migration, en économie et en politique financière, en emploi et en mobilité de la main-d'œuvre, en égalité des sexes, en environnement, en politiques de protection sociale (santé et retraite).
Résultats attendus
Ce projet multidisciplinaire (sociologie , sciences politiques, économie) est structuré en trois composantes :
- Production d’une revue de littérature académique des enjeux du vieillissement dans la région des Balkans (avancées et connaissances scientifiques des enjeux socio-économiques, territoriaux et migratoires liés au vieillissement au niveau régional) ;
- Trois études-pays ;
- Des publications et activités de valorisation, pour disséminer les connaissances d’une part et alimenter le dialogue de l’AFD avec ses partenaires publics d’autre part.
Vous souhaitez suivre l'actualité de la recherche à l'AFD ?
Contact
-
Serge RABIER
Chargé de recherche, socio-démographe