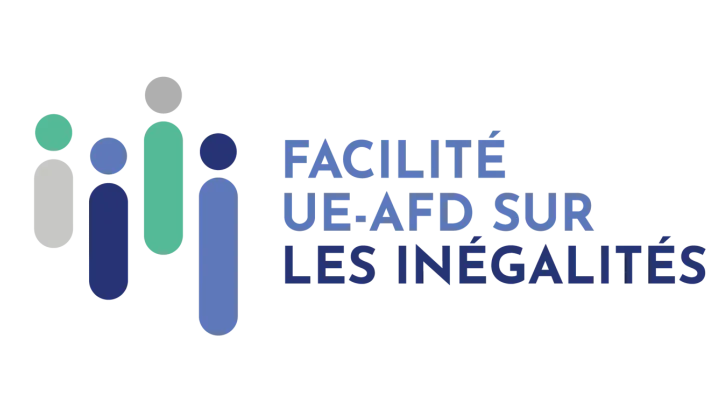Partager la page
FSC, PEFC : le long chemin vers des exploitations certifiées durables
Publié le

L’augmentation constante du nombre de forêts certifiées atteste de la réussite de ces labels environnementaux. Mais que garantissent-ils exactement ? Retour sur leur genèse.
« Les ressources et les terres forestières doivent être gérées d’une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures », clame la communauté internationale réunie à Rio, en 1992, lors du Sommet de la Terre. Au cours de la précédente décennie, le taux de déforestation global annuel a atteint les 15,4 millions d’hectares. La gestion des forêts, et particulièrement des forêts tropicales qui représentent la moitié de la surface forestière mondiale et demeurent sensibles aux pressions humaines, doit désormais être faite de façon durable.
Auparavant, plusieurs initiatives d’éco-certification de la filière avaient vu le jour. Comme le Good Wood Guide, publié au milieu des années 1980 par l’ONG Les Amis de la Terre, qui distinguait les opérateurs aux comportements éthiques. Ainsi que le programme de certification de l’ONG Rainforest Alliance, lancé en 1990, recensant les bois issus des exploitations vertueuses.
Naissance du label FSC
Suite au Sommet de Rio, un groupe réunissant des distributeurs spécialisés dans le bricolage et l’outillage ainsi que des ONG environnementales – dont Greenpeace, WWF et Rainforest Alliance – va aller plus loin. Il imagine un système de certification d’une gestion forestière durable par un tiers de confiance international où les différents intérêts économiques, sociaux et environnementaux seraient représentés. En 1993, le label Forest Stewardship Council (FSC) voit ainsi le jour.
Ce label défend une dizaine de principes de gestion responsable, parmi lesquels la mise en place d’un plan d’aménagement forestier, le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, l’évaluation régulière de l’état du domaine ou encore le maintien des écosystèmes.
Lire aussi : Comment l’AFD se mobilise pour protéger l’Amazonie
Les plans d’aménagement, mis en place par les États, permettent d’établir un certain nombre de règles dans les concessions forestières : interdiction de convertir les forêts à un autre usage, partage d’une partie des bénéfices avec les populations locales, protection totale de certaines parcelles prisées des grands mammifères en danger d’extinction… Ils précisent aussi les conditions dans lesquelles les opérations d’exploitation forestière doivent se dérouler : un arbre trop proche d’une rivière ou d’un marécage ne sera par exemple pas abattu.
Moins de conséquences néfastes
En plus d’offrir aux consommateurs la garantie que leur achat a moins de conséquences néfastes sur la planète que les produits concurrents, les écolabels ont un réel impact pour les populations locales. Une étude menée par le Centre de recherche forestière internationale (Cifor) sur le bassin du Congo révèle que les conditions de vie et de travail, ainsi que la répartition des richesses, sont meilleures au sein des zones forestières certifiées FSC comparées aux zones non certifiées mais bénéficiant néanmoins d’un plan d’aménagement. « La certification dans le bassin du Congo a été en mesure de pousser les entreprises vers un progrès social significatif », conclut le Cifor.
La filière forêt-bois, constituée de propriétaires forestiers et d’industriels du bois, développe son propre système de certification en 1999 : le Programme de reconnaissance des certifications forestières, dit PEFC. Il s’agit là aussi de garantir une exploitation forestière respectueuse des dimensions économiques, sociales et environnementales.
FSC et PEFC s’appuient tous deux sur le principe du volontariat. La certification n’est délivrée qu’aux opérateurs qui en font la démarche. Ils interdisent aussi le recours à l’utilisation d’arbres OGM – permettant pourtant une croissance 20 % plus rapide. Ces deux schémas se rejoignent dans leur vocation.
Un standard adapté à chaque pays
L’une des différences majeures entre les deux systèmes réside dans le processus d’élaboration des normes nationales. Pour le PEFC, le standard générique de certification est établi à l’échelle régionale ou nationale puis validé par l’instance internationale. À l’inverse, le FSC a mis en place un standard générique international qui est ensuite adapté à chaque pays.
Lire aussi : En Turquie, les forêts sur le front de la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité
Le FSC dispose également d’un organisme indépendant accréditant les bureaux d’audits au niveau international, et les contrôle de façon inopinée. Le PEFC garantit de son côté la mise en place au niveau de chaque pays d’un système d’accréditation nationale crédible et viable.
Environ 13 % des forêts mondiales sont aujourd’hui éco-certifiées, contre 9 % il y a dix ans. Parmi celles-ci, les deux tiers affichent le label PEFC (325 millions d’hectares) ou FSC (207 millions). Ce dernier reste néanmoins le plus répandu au sein des forêts naturelles tropicales. Dans le même temps, 87 % des forêts mondiales ne font l’objet d’aucun contrôle de gestion socio-environnementale externe et fiable.
Encourager la certification
L’Agence française de développement apporte depuis près de trente ans son soutien technique et financier à l’établissement d’une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo – l’aire géographique regroupant le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la République du Congo. 33 projets y ont été appuyés dans ce secteur entre 1999 et 2015.
Ce soutien a contribué à l’émergence des premières certifications FSC dans la région en 2005. Quatorze ans plus tard, 5,4 millions d’hectares y sont certifiés FSC. Mais le chemin est encore long puisque ce chiffre représente seulement 10 % des forêts exploitées dans le bassin du Congo.