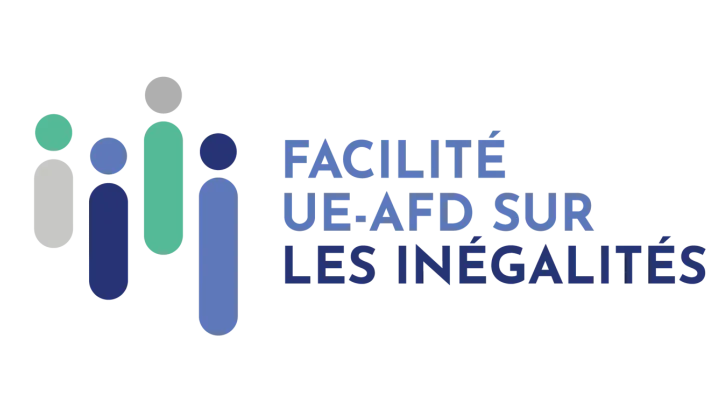Partager la page
Comment mieux associer les populations locales à la gestion des forêts ?
Publié le

Condition indispensable pour une gestion durable des forêts, la participation des populations locales et autochtones se heurte à de nombreux obstacles. Pour encourager celle-ci, l’Agence française de développement apporte son soutien à plusieurs programmes.
La nécessité d’impliquer les populations autochtones et locales dans les plans d’aménagement forestier ne fait plus débat aujourd’hui. Et pourtant, l’idée que les acteurs privés du secteur forestier ne leur devaient rien d’autre qu’un accès à la forêt et à ses services était pourtant répandue il y a une vingtaine d’années.
Un tournant s’opère, à la fin des années 1960, lorsque l’écologue américain Garrett Hardin popularise le concept de « tragédie des biens communs » : l’exploitation d’une ressource commune (eau, forêt, monument historique…) la mène inexorablement à sa perte. Pour la préserver, on peut la nationaliser afin d’établir une réglementation d’accès. Ou bien, comme le préconise Hardin, la privatiser pour une gestion rationnelle. Tant pis si cela entraîne des inégalités sociales d’accès à ladite ressource.
Changement de paradigme
Mais au début des années 1990, l’Américaine Elinor Ostrom soutient qu’il est préférable de confier la gestion des biens communs aux populations riveraines plutôt qu’aux acteurs étatiques ou privés. Ses travaux sur cette nouvelle forme de gouvernance, à l’opposé des solutions traditionnelles, lui vaudront le prix Nobel d’économie.
Lire aussi : Avec le projet TerrIndigena, renforcer les communautés autochtones d'Amazonie
À cette époque, la communauté internationale prend conscience de la nécessité d’inclure les populations concernées : « Les populations indigènes, leurs communautés et les autres communautés locales ont un rôle vital dans la gestion et le développement environnemental en raison de leurs savoirs et de leurs pratiques traditionnelles », peut-on lire dans l’Agenda 21, plan d’action adopté par les 182 pays réunis lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992.
Au tournant du XXIe siècle, la participation des populations locales est inscrite dans le code forestier d’une quinzaine de pays : Philippines, Cameroun, Tanzanie, Madagascar, Indonésie, Zambie, Guinée, Cambodge…
Gestion conjointe des forêts
Ce transfert des compétences prend plusieurs formes d’une région à l’autre. Il y a d’abord la gestion conjointe des forêts – ou Joint Forest Management (JFM) – adoptée en Tanzanie, en Éthiopie, au Ghana et en Inde, nation pionnière de ce type de gouvernance. Leur gestion y est désormais conduite par des représentants des communautés villageoises ainsi que des membres de l’administration forestière, soit l’État.
Vient ensuite la foresterie communautaire. Cette fois-ci, les communautés peuvent obtenir un droit d’aliénation, c’est-à-dire le pouvoir de vendre leur terre ou de les gérer selon leurs propres modèles de développement. Au Mexique, pays fortement marqué par la décentralisation, 80 % des zones forestières sont concernées par cette forme de gestion. L’État se contente simplement de veiller à la conformité légale des décisions prises par les populations.
Citons enfin la gestion communale, très fréquente au Cameroun par exemple. Ce système ressemble à la gestion communautaire, à la différence qu’il s’appuie sur la commune (et non sur la communauté), soit une entité à l’existence juridique.
De la théorie à la pratique
Sur le papier, ces nouvelles formes de gestion participative ont évidemment de sérieux atouts. Sur le terrain, de nombreux obstacles nuisent pourtant à leur bon déroulement. Tout d’abord, l’État doit impérativement faire preuve de stabilité. Il faut aussi qu’il respecte le contrat de gestion passé avec les populations. À Madagascar, des habitants des forêts se sont plaints, par exemple, de voir arriver des personnes étrangères à leur communauté et munies d’une autorisation d’abattage délivrée par l’administration forestière.
Il arrive également que le projet soit détourné en défaveur des populations riveraines. Dans le bassin du Congo, certaines créations de forêts communautaires n’ont pas été à l’initiative des habitants, mais d’acteurs extérieurs – ONG, exploitant forestier, bailleur de fonds… – aux intérêts propres et pas nécessairement convergents. Des communautés locales ont ainsi perçu des compensations financières pour la ressource prélevée – certaines ont aussi été embauchées – sans toutefois avoir leur mot à dire sur la gestion forestière.
Des projets récents tentent de renforcer les capacités de gestion des communautés, afin que le modèle jusque-là théorique des forêts communautaires dans le bassin du Congo conduise à un meilleur mécanisme de partage des bénéfices et à une gestion par les communautés de leurs paysages forestiers ancestraux.
Paternalisme et laxisme
L’exploitation forestière requiert cependant d'importants moyens financiers et matériels dont les communautés locales ne disposent généralement pas encore. Mais la création de partenariats durables et équitables avec des opérateurs privés ou des organisations internationales pourrait être une piste pour développer ce modèle forestier communautaire.
Cette gestion participative ne peut cependant fonctionner que si la communauté est suffisamment structurée et réellement solidaire. Dans certaines localités, les retombées économiques se traduisent par une amélioration des infrastructures et des routes, ou un accroissement du taux de scolarisation. Mais il arrive parfois, comme l’a révélé le Centre de recherche forestière internationale (Cifor) au cours d’une étude de cas en Afrique centrale, que seules les élites communautaires profitent des avantages de l’exploitation du bois.
« Au stade actuel, le mode de gouvernance participatif apparaît empreint de paternalisme, de laxisme, d’abus de pouvoir et de corruption », concluait en 2014 un article sur la gestion participative des forêts en Afrique centrale publié dans La Revue d’ethnologie. Les auteurs de l’étude pointaient du doigt un fonctionnement dirigiste hérité de la période coloniale.
Entreprenariat forestier communautaire
La gouvernance participative serait-elle une chimère ? « La foresterie communautaire n’est pas condamnée à l’échec, mais elle doit être conduite de façon prudente. Il y a des exemples heureux, comme au Bénin autour du bois-énergie », tempère Christophe du Castel, référent biodiversité à l’Agence française de développement (AFD).
Pour pallier la dépossession des projets, plusieurs ONG encouragent l’entrepreneuriat auprès des populations locales, en Afrique centrale, au Panama, en Bolivie ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les habitants peuvent alors se réapproprier les projets grâce à des formations visant à accroître leurs capacités techniques, organisationnelles et managériales.
En Afrique centrale, depuis 2009, le Réseau africain de forêts modèles (RAFM) s’efforce de replacer les femmes au centre des projets, et donc de la vie économique. Des sessions de formation et d’accompagnement ont été créées à leur attention. Ainsi, dans deux forêts du Cameroun où les communautés ont rejoint le réseau, les femmes se sont lancées dans la production et la commercialisation de produits forestiers non ligneux, tels que les champignons, le miel, des huiles et produits cosmétiques à base de plantes tropicales.
L’AFD aux côtés des populations
Au Cameroun encore, 3 % des terres forestières sont actuellement reconnues comme forêts communautaires ou communales. Le chiffre peut, à première lecture, paraître bien faible. Mais il faut savoir que seulement 10 % de la forêt camerounaise a été rétrocédée aux populations locales.
Lire aussi : Au Nord-Congo, un projet associe les habitants à la gestion des forêts pour mieux les protéger
L’AFD a apporté son soutien technique et financier à l’établissement de programmes visant à améliorer les compétences en gestion des populations locales. Le soutien à des plateformes multi-acteurs est également plébiscité, afin que ces populations aient voix au chapitre.
En République du Congo, le projet paysage forestier Nord-Congo financé par l’AFD doit par exemple aider les populations autochtones et les communautés locales riveraines à structurer les débouchés commerciaux des forêts qui leur ont été attribuées par voie règlementaire. Malgré les difficultés politiques et structurelles, la gestion participative demeure, à n’en pas douter, une solution d’avenir.